Maupassant : Bel Ami, chronique d’un affamé
Je viens de me replonger avec délectation dans l’univers littéraire de Maupassant en lisant/relisant plusieurs de ces contes, puis son roman « Bel Ami ». On dit l’auteur réaliste, voire pessimiste et c’est vrai qu’il n’a pas son pareil pour dépeindre la vie humaine dans toute sa médiocrité. On trouve dans ses textes les mésaventures de pauvres diables mus par leur égoïsme, leur bêtise, leur aveuglement… et le monde semble définitivement sans âme en devenant un vaste panier de crabes ou chacun pince son voisin sans trop savoir pourquoi…
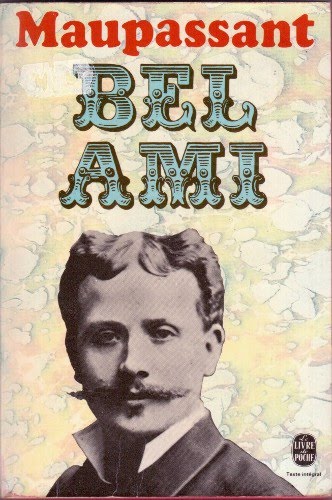
On peut trouver cela déprimant… mais on peut aussi en rire, ce qui est sans doute l’attitude la plus raisonnable face à toute cette petitesse, qu’on la trouve sous la plume talentueuse de Maupassant ou dans notre existence quotidienne. Après tout, cela est si « humain » !
Et si Maupassant exprime avec génie toutes ces turpitudes ordinaires, il est aussi à son aise lorsqu’il s’agit d’exprimer un certain bonheur quotidien ou encore d’autres réalités beaucoup moins banales.
C’est par exemple le cas de la peur et de la folie comme dans le fameux « Horla », mais aussi dans « L’Auberge » que je considère comme un des récits les plus terrifiants que j’ai lus jusqu’ici…
Et même dans ses récits plus réalistes, on trouve ici et là quelques fleurs sauvages, où le poète, le révolté… trouve à s’exprimer.
Et dans le fond, n’est-ce pas parce que cet auteur est si habile à nous conter toute la lourdeur et le côté grisâtre du monde, qu’il sait également aussi puissamment évoquer la folie ou encore les élans de révoltes comme autant de portes de sortie de cette réalité ?
Pour en venir à son roman « Bel Ami », on retrouve ici son talent si particulier qui lui permet de toucher la réalité de si près. Je pense à la façon dont il décrit avec acuité les divers sentiments de son personnage principal : sa timidité lors de sa première soirée mondaine, ses tourments la nuit précédant son duel ou encore ses bouffées d’orgueil une fois « parvenu »…
J’ai titré cet article « chronique d’un affamé », car si Duroy se lance avec opportunisme dans sa carrière imprévue de journaliste du fait d’une situation initiale ou effectivement il peine à joindre les deux bouts et à manger à sa faim, il ne parvient manifestement jamais à être vraiment rassasié.
Si on veut éviter de le juger au nom d’une quelconque morale de comptoir, on peut saluer le talent de Duroy tant il sait faire preuve de ruse, d’opportunisme, de séduction pour parvenir à ses fins. Toujours prêt à retourner sa veste, à louvoyer, à s’adapter à son environnement…
Et effectivement, chez Maupassant pas de morale à l’histoire. Son personnage joue finement en faisant preuve de peu de scrupules quitte à léser ceux qui ont le malheur de croiser son chemin… et il gagne, avance ses pions, car il n’y a aucune justice immanente pour punir l’ambitieux.
Pour autant, s’il parvient bien à ses fins, et finit même par acquérir ses « lettres de noblesse » au sens premier du terme, il semble bien loin de les acquérir au sens imagé.
Non parce que cela est « mal » d’agir ainsi et que l’on devrait prendre l’air offusqué de voir ainsi le triomphe d’une sorte de crapule ordinaire, sans foi ni loi. Mais bien plutôt, par ce que tout le long de son élévation sociale il continue à se comporter comme un « affamé » jamais satisfait, toujours tiraillé par son besoin de « toujours plus », ses preuves de réussite n’étant par ailleurs au final que celles communément admises par la société de son époque.
Donc il ne crée pas ses propres valeurs, il ne sait pas se satisfaire de sa juste part mais reste soumis à cette avidité viscérale qui le tire infiniment vers ce « toujours plus ». Il ne fait preuve d’aucune réelle liberté de pensée ou d’action, tant il est accaparé par son interaction avec le monde extérieur.
Son collègue, Norbert de Varenne est peut-être de ceux qui ont au moins le mérite d’essayer de vraiment « réussir » leur vie, c’est-à-dire en la forgeant à leur manière, comme le poète qu’il est.
Mais au final, l’un comme l’autre, apparaissent comme bien seuls dans leurs mésaventures (bien que Duroy soit très entouré), ce qui est vrai pour la majorité des personnages de Maupassant, sur ce point encore très « réaliste ». Est-ce là la morale de l’histoire ?
Extraits de « Bel Ami » à lire en intégrité sur In Libro Veritas
Les deux hommes ne parlèrent point dans les premiers moments. Puis Duroy, pour dire quelque chose, prononça :
« Ce M. Laroche-Mathieu a l’air fort intelligent et fort instruit. »
Le vieux poète murmura : « Vous trouvez ? »
Le jeune homme, surpris, hésitait : « Mais oui ; il passe d’ailleurs pour un des hommes les plus capables de la Chambre.
– C’est possible. Dans le royaume des aveugles les borgnes sont rois. Tous ces gens-là, voyez-vous, sont des médiocres, parce qu’ils ont l’esprit entre deux murs, l’argent et la politique. Ce sont des cuistres, mon cher, avec qui il est impossible de parler de rien, de rien de ce que nous aimons. Leur intelligence est à fond de vase, ou plutôt à fond de dépotoir, comme la Seine à Asnières.
« Ah ! c’est qu’il est difficile de trouver un homme qui ait de l’espace dans la pensée, qui vous donne la sensation de ces grandes haleines du large qu’on respire sur les côtes de la mer. J’en ai connu quelques-uns, ils sont morts. »
Norbert de Varenne parlait d’une voix claire, mais retenue, qui aurait sonné dans le silence de la nuit s’il l’avait laissée s’échapper. Il semblait surexcité et triste, d’une de ces tristesses qui tombent parfois sur les âmes et les rendent vibrantes comme la terre sous la gelée.
Il reprit :
« Qu’importe, d’ailleurs, un peu plus ou un peu moins de génie, puisque tout doit finir ! »
Et il se tut.
Duroy, qui se sentait le cœur gai, ce soir-là, dit, en souriant :
« Vous avez du noir, aujourd’hui, cher maître. »
Le poète répondit.
« J’en ai toujours, mon enfant, et vous en aurez autant que moi dans quelques années. La vie est une côte. Tant qu’on monte, on regarde le sommet, et on se sent heureux ; mais, lorsqu’on arrive en haut, on aperçoit tout d’un coup la descente, et la fin qui est la mort. Ça va lentement quand on monte, mais ça va vite quand on descend. À votre âge, on est joyeux. On espère tant de choses, qui n’arrivent jamais d’ailleurs. Au mien, on n’attend plus rien… que la mort. »
Duroy se mit à rire :
« Bigre, vous me donnez froid dans le dos. »
Ils arrivaient au pont de la Concorde, ils le traversèrent en silence, puis ils longèrent le Palais-Bourbon.
Norbert de Varenne se remit à parler :
« Mariez-vous, mon ami, vous ne savez pas ce que c’est que de vivre seul, à mon âge. La solitude, aujourd’hui, m’emplit d’une angoisse horrible ; la solitude dans le logis, auprès du feu, le soir. Il me semble alors que je suis seul sur la terre, affreusement seul, mais entouré de dangers vagues, de choses inconnues et terribles ; et la cloison, qui me sépare de mon voisin que je ne connais pas, m’éloigne de lui autant que des étoiles aperçues par ma fenêtre. Une sorte de fièvre m’envahit, une fièvre de douleur et de crainte, et le silence des murs m’épouvante. Il est si profond et si triste, le silence de la chambre où l’on vit seul. Ce n’est pas seulement un silence autour du corps, mais un silence autour de l’âme, et, quand un meuble craque, on tressaille jusqu’au cœur, car aucun bruit n’est attendu dans ce morne logis. »
C’était un de ces hommes politiques à plusieurs faces, sans conviction, sans grands moyens, sans audace et sans connaissances sérieuses, avocat de province, joli homme de chef-lieu, gardant un équilibre de finaud entre tous les partis extrêmes, sorte de jésuite républicain et de champignon libéral de nature douteuse, comme il en pousse par centaines sur le fumier populaire du suffrage universel.
Extraits de « Amour »
Je suis né avec tous les instincts et le sens de l’homme primitif tempérés par des raisonnements et des émotions de civilisé. J’aime la chasse avec passion ; et la bête saignante, le sang sur les plumes, le sang sur mes mains, me crispent le cœur a en le faire défaillir.
J’aime l’eau d’une passion désordonnée : la mer, bien que trop grande, trop remuante, impossible à posséder, les rivières si jolies mais qui passent, qui fuient, qui s’en vont, et les marais surtout où palpite toute l’existence inconnue des bêtes aquatiques. Le marais, c’est un monde entier sur la terre, monde différent, qui a sa vie propre, ses habitants sédentaires, et ses voyageurs de passage, ses voix, ses bruits et son mystère surtout. Rien n’est plus troublant, plus inquiétant, plus effrayant, parfois, qu’un marécage. Pourquoi cette peur qui plane sur ces plaines basses couvertes d’eau ? Sont-ce les vagues rumeurs des roseaux, les étranges feux follets, le silence profond qui les enveloppe dans les nuits calmes, ou bien les brumes bizarres, qui traînent sur les joncs comme des robes de mortes, ou bien encore l’imperceptible clapotement, si léger, si doux, et plus terrifiant parfois que le canon des hommes ou que le tonnerre du ciel, qui fait ressembler les marais à des pays de rêve, à des pays redoutables, cachant un secret inconnaissable et dangereux.
Extrait de « Yvette »
Les buveurs, autour des tables, engloutissaient des liquides blancs, rouges, jaunes, verts et criaient, vociféraient sans raison, cédant à un besoin violent de faire du tapage, à un besoin de brutes d’avoir les oreilles et le cerveau pleins de vacarme.
Extrait « La peur »
La peur (et les hommes les plus hardis peuvent avoir peur), c’est quelque chose d’effroyable, une sensation atroce, comme une décomposition de l’âme, un spasme affreux de la pensée et du cœur, dont le souvenir seul donne des frissons d’angoisse. Mais cela n’a lieu, quand on est brave, ni devant une attaque, ni devant la mort inévitable, ni devant toutes les formes connues du péril : cela a lieu dans certaines circonstances anormales, sous certaines influences mystérieuses, en face de risques vagues. La vraie peur, c’est quelque chose comme une réminiscence des terreurs fantastiques d’autrefois. Un homme qui croit aux revenants, et qui s’imagine apercevoir un spectre dans la nuit, doit éprouver la peur en toute son épouvantable horreur.
Extrait du « Horla »
Certes, la solitude est dangereuse pour les intelligences qui travaillent. Il nous faut autour de nous, des hommes qui pensent et qui parlent. Quand nous sommes seuls longtemps, nous peuplons le vide de fantômes.
C’est pourtant fort bête d’être joyeux, à date fixe, par décret du gouvernement. Le peuple est un troupeau imbécile, tantôt stupidement patient et tantôt férocement révolté. On lui dit : « Amuse-toi. » Il s’amuse. On lui dit : « Va te battre avec le voisin. » Il va se battre. On lui dit : « Vote pour l’Empereur. » Il vote pour l’Empereur. Puis, on lui dit : « Vote pour la République. » Et il vote pour la République.
Ceux qui le dirigent sont aussi sots ; mais au lieu d’obéir à des hommes, ils obéissent à des principes, lesquels ne peuvent être que niais, stériles et faux, par cela même qu’ils sont des principes, c’est-à-dire des idées réputées certaines et immuables, en ce monde où l’on n’est sûr de rien, puisque la lumière est une illusion, puisque le bruit est une illusion.